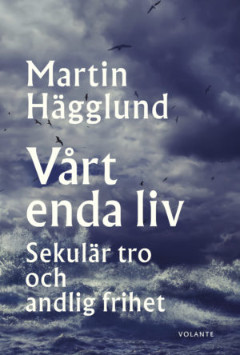Martin Hägglund est un philosophe suédois. Il enseigne les lettres à l’Université de Yale et publie dans différents journaux, notamment le New York Times. Il a reçu le prix littéraire Schückska de l’Académie suédoise en 2014 pour un livre consacré à l’étude du temps ainsi que le prix René Wellek en 2020 pour son nouvel ouvrage ici présenté, « Notre seule vie ». Ce dernier bénéficie à sa sortie en 2019 aux États-Unis puis en 2020 en Suède dans une version plus étoffée d’une audience large et de nombreuses critiques favorables. Cette publication a par ailleurs fait l’objet de journées d’études dans les universités de Harvard et de Yale.
Titre original : Vårt enda liv – Sekulär tro och andlig frihet
Suggestions du titre français : « Notre seule vie » ou « Notre seule vie – foi séculaire et liberté spirituelle » Auteur : Martin Hägglund
Nombre de pages : 455 pages
Maison d’édition et agence : Volante (maison d’édition en Suède) / Inkwell Management (agence)
Personnes à contacter : Lyndsey Blessing (agente) (lyndsey@inkwellmanagement.com) / Tobias Nielsén (tobias@volante.se)
Année de parution : 2019 (version anglaise) ; 2020 (version suédoise ici présentée)
Présenté par : Théo Fouéré
Comment proposer et réactualiser une pensée d’inspiration marxiste à une époque où les idéologies et notamment celles ayant trait au socialisme ont perdu presque tout crédit ? C’est à ce travail que s’attèle Martin Hägglund dans « Notre seule vie ». La non-existence de Dieu, la non-existence de solutions miracles aux problèmes auxquels l’humanité fait face constituent des points essentiels de la pensée du philosophe suédois. Les crises climatique, sociale, sanitaire (l’ouvrage a été publié peu avant le début de la pandémie dans sa première version, rendant son propos d’autant plus actuel) nécessitent que l’on se penche en profondeur sur ce qui peut sauver notre être collectif, notre héritage passé et à venir.
Hägglund se plonge dans la pensée déjà produite, littéraire et philosophique principalement, ainsi que sur l’expérience personnelle pour proposer une conception viable de la vie, qui soit la plus émancipatrice possible. On peut établir un parallèle entre le danois Kierkegaard, exhortant pourtant au “saut dans le religieux”, et le suédois Hägglund qui ne croit pas en Dieu, rattachables à l’existentialisme. Chez les deux penseurs, l’existence est porteuse d’une signification et d’une multitude de possibilités qui la rendent unique. Hägglund s’émancipe cependant du fait religieux, le critiquant pour sa propension à leurrer les individus sur l’existence de l’éternel. C’est parce que la vie est finie et fragile qu’elle est précieuse. La “foi séculaire” est possible selon Hägglund en-dehors des religions et de leur croyance en la vie éternelle.
Cet essai porte aussi sur l’organisation sociale et politique qu’il est souhaitable de construire. L’idéal est selon Hägglund de constituer un ordre social dans lequel l’humain cesse d’exploiter les richesses qu’il n’a pas ou plus et qui lui permettra en outre de “posséder” son propre temps. Cela nécessite d’évaluer notre système de valeur actuel, qui nous pousse à surconsommer, nous éloigne de la pensée et nous éloigne de la
liberté telle qu’elle devrait être conçue dans une société pleinement démocratique.